Lettre du 2 septembre 1861
Ma bien chère Elisabeth,
J’étais impatiente de reprendre la plume pour vous raconter
la suite de mes aventures, mais mon tendre Hubert rôdaillait dans mes
appartements depuis la fameuse journée.
Heureusement, aujourd’hui, ces affaires l’ont à nouveau emmené
en ville et je vous révèle enfin le déroulement de mon entrevue avec qui vous savez.
Comme je vous l’ai expliqué dans ma précédente missive,
j’avais décidé de porter ma plus ample crinoline, afin de lui offrir le plus
d’espace possible pour ses friponneries. Je m’étais parée de mes perles et
j’emportais aussi mon ombrelle, afin que l’ivoire de ma peau délicate ne se
tanne pas au grand air.
Ainsi apprêtée, je ne voulais pas traîner sur le perron. Que
penseraient les serviteurs ? J’ai donc accédé à la porte dérobée située à
l’angle ouest du domaine. En traversant le petit cloître, j’ai pris grand soin
de ne marcher que sur l’herbe, qui atténuait le bruit de mes bottines. Les
gravillons, quant à eux, semblaient de mèche avec mon mari : à peine je
les effleurais qu’ils s’égosillaient pour me dénoncer.
Mon courtisan ne tarda pas à me rejoindre près du portillon.
Il portait un élégant haut-de-forme et un léger masque de satin noir lui
cachait le front et les pommettes. Ses yeux de braises avaient chantourné deux
orifices lui permettant de voir sans être reconnu pour autant.
Nous n’avons pas perdu de temps à nous conter fleurette. Il
m’a offert son bras, afin de traverser sans encombre la route couverte de
défécation équine. Echappant aux tumultes des diligences, nous nous faufilâmes dans
une étroite ruelle qui nous permit de quitter le bourg en toute discrétion.
Mon gentilhomme m’escorta galamment jusqu’à l’orée des bois.
Non loin de là chantonnait une source. Les oiseaux gazouillaient dans les
branches alentours. Je ne parle pas, là, uniquement de ce qui se passait hors
de ma robe.
La langue de mon mirliflore affichait plus d’entrain à
humecter les pétales rosés de mon jardin secret que de se perdre en
marivaudages improductifs.
Il s’occupa de mon bourgeon jusqu’à ma félicité. Mon
mousquetaire sortit alors son fleuret pour servir sa majesté, sans la blesser. Il
fit un tour de garde avant de s’enfoncer dans les bas quartiers.
Je vous passe toutes les polissonneries dont ce notable m’a
gratifiées, chère Elisabeth, car je crains que le temps me presse et je tiens
absolument à terminer mon récit dans cette lettre.
Après avoir chacun repris ce qui lui appartenait, nous
rebroussâmes chemin. Il m’a chaperonnée jusqu’aux pavés devant la Collégiale.
Sur la place, les flâneurs s’étaient rassemblés. Mon guide, ayant perdu son
loup au bord de l’eau, m’astreignit d’un regard à me mêler à la foule, afin de préserver
notre anonymat.
Je crus d’abord que cet attroupement était le fait d’un vil
gredin qui s’épanchait publiquement sur ses états d’âmes à propos de
l’abolition de l’esclavage, mais il n’en était rien. Il s’agissait seulement d’un
montreur de singe.
Mon gentilhomme profita de l’agitation pour m’adresser un
dernier sourire. Je lui lançai alors une œillade pleine de désirs fébriles
avant qu’il ne s’esquive. Je restais là quelques instants afin de profiter du
spectacle et dissiper toute suspicion d’une liaison entre la châtelaine et ce
sire.
Au milieu des mines amusées, je distinguai soudainement un
visage immobile. Les pupilles de mon époux étaient rivées sur moi. Depuis
combien de temps ? Avait-il deviné les folies que j’avais accomplies avec
son associé ?
De tout temps, j’avais imaginé que si Hubert venait à découvrir
ma légèreté, il se lancerait à ma poursuite dans une cavalcade insensée et me
traînerait par les cheveux sur la place publique, afin de me répudier, me
chasser, me bannir de sa ville.
Mais ce ne fut pas le cas.
Il semblait déconfit. Incontestablement il avait tout vu. Cependant
il n’affichait aucune volonté d’exposer son cocufiage à l’assistance composée notamment
de ses investisseurs de passage.
Il ne rentra qu’après les vêpres et ne m’adressa aucunement
la parole ni ne me lâcha d’une semelle. Il me suivait jusqu’au cabinet d’aisance,
pour vous dire.
Jusqu’à ce matin, où mon geôlier avait sa pause hebdomadaire
avec l’Aristotélicienne de l’hostellerie de la gare. Homme de bonne volonté, il
n’est cependant pas affublé d’endurance.
Voilà pourquoi je me presse de cacheter ce pli. Aux bons
soins de Joséphine, je sais que vous l’aurez entre les mains dans moins d’une
heure.
Agréez, ma très chère Elisabeth, que je vous embrasse en attendant
de découvrir quelles frasques vous avez inventés avec ce bon Joseph.
Marie-Antoinette



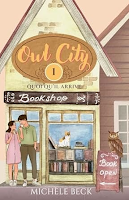
Commentaires
Enregistrer un commentaire